Programme
Aperçu du déroulement de la journée
L'événement mise résolument sur la participation et se nourrit des connaissances, des expériences et des questions apportées par chaque participant·e. La valeur ajoutée en termes de contenu réside dans les interactions entre les participant·es. Les questions spécifiques abordées dans les différents formats de dialogue sont actuellement élaborées en collaboration avec les facilitateurs et les acteurs de terrain.
08:30 Accueil
Échange informel autour d’un croissant et d’un café
09:00 Début – partie en commun
Introduction au thème et dialogue en plénière
Répartition en groupes de dialogue
09:30 Début des formats de dialogue systémiques
Voir les formats de dialogue ci-dessous
13:00 Dîner
14:00 Synthèse des enseignements
Worldcafé ou configuration spéciale Fish Bowl
Voix en plénière
15:30 Pause
15:45 Et maintenant ?
Groupes de travail Open Space
16:45 Conclusion commune
17:15 Fin de l’événement et apéritif
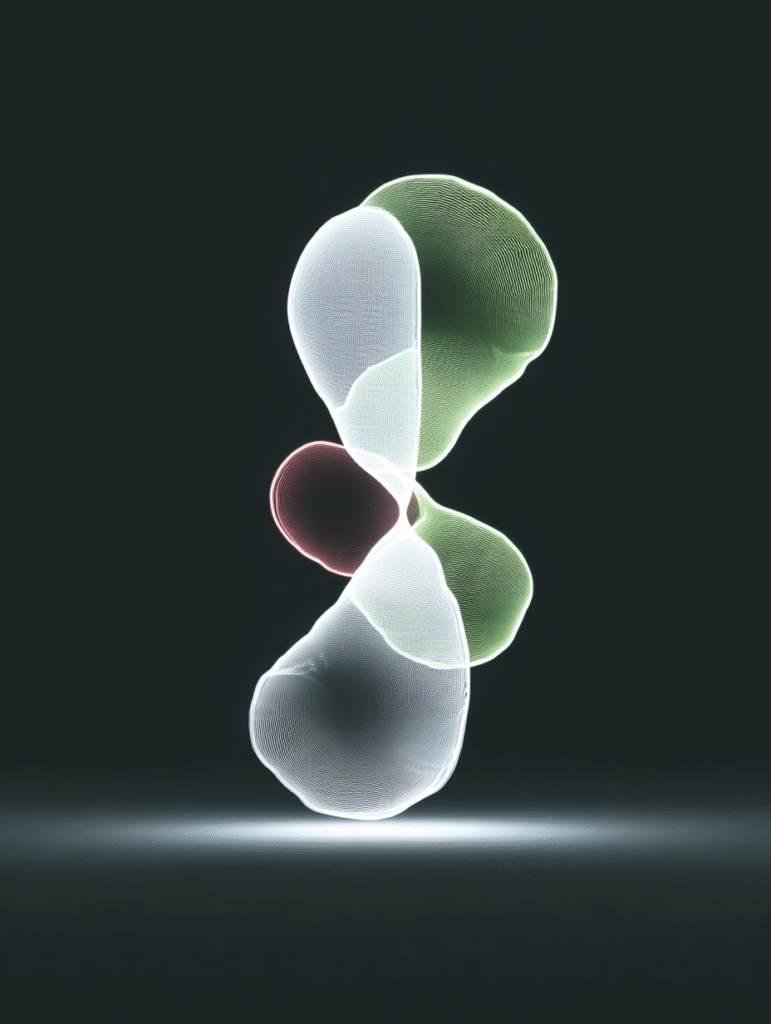
F.A.Q.
Questions et réponses concernant l'événement et son approche méthodologique
Pourquoi précisément ces méthodes ?
Nous misons délibérément et systématiquement sur la participation, l’exploration et l’interaction. C’est pourquoi nous avons complètement renoncé aux formats tels que les discours liminaires, les exposés ou les tables rondes.
Nous sommes convaincus que les connaissances nécessaires à une réflexion constructive sur le thème de la coexistence sont apportées par les participants eux-mêmes. Nous sommes également persuadés que la valeur du dialogue réside avant tout dans la conversation directe entre les participants.
Les formats de dialogue choisis doivent contribuer à éclairer la réflexion sur les questions et les défis liés au thème de la coexistence à partir de différentes perspectives, expériences et réalités quotidiennes. Cela crée un espace de dialogue permettant de discuter ensemble au-delà des positions ou convictions individuelles. L’accent est mis sur l’examen des relations et des interactions entre les différents acteurs et leurs contextes. Dans l’idéal, cela nous permettra de remettre en question les hypothèses existantes et, grâce à une compréhension élargie, d’ouvrir de nouvelles possibilités ou approches pour une coexistence réussie.
Comment puis-je me préparer ?
En principe, aucune préparation n’est nécessaire. Il est toutefois utile de réfléchir aux questions suivantes :
- Quelles sont les raisons qui me motivent à participer de manière constructive à un dialogue avec d’autres acteurs ? Quelles opportunités, synergies ou autres pourraient en découler pour moi/nous ?
- Quelles questions me préoccupent ?
- Qu’est-ce qui me tient à cœur ? Et pour quelles causes ou préoccupations suis-je prêt à m’engager ?
- Quelles opinions ou positions voudrais-je mieux comprendre ?
- Quelles sont mes hypothèses et mes idées sur les « autres » et quelle influence cela pourrait-il avoir sur mon travail ? Dans quelle mesure serait-il pertinent que celles-ci ne se confirment pas ou changent ?
Puis-je assister seulement à certaines parties de l'événement ?
Non, l’événement dure toute la journée et les activités s’enchaînent. Dans certains cas exceptionnels, nous pouvons faire des exceptions sur demande. Pour cela, contactez-nous par e-mail à l’adresse info@dialog-gentechnik.ch.
Quels résultats peut-on attendre d'un processus aussi ouvert ?
Tu peux t’attendre à de nombreux échanges directs et à une compréhension plus approfondie des circonstances, des motivations ou des expériences d’autres acteurs qui évoluent dans le contexte de la coexistence.
La qualité des résultats dépend de la volonté des participants à mener une discussion honnête et ouverte, même sur des opinions ou des positions délicates.
Dans la dernière partie de l’événement, nous souhaitons offrir la possibilité de concrétiser les premières idées ou impulsions qui auront émergé.
Combien coûte l'événement ?
La manifestation est gratuite pour les participants.

Matinée : Formats de dialogue systémique
Aperçu
- Voyage d’apprentissage avec Théo Fischer
- Penser l’avenir avec Lena Tünkers
- Exploration de modèles 3D avec Severin von Hünerbein
- Travail sur les processus, facilitation à confirmer
- Lego Serious Play avec Florian Wieser
Remarque : nous développons actuellement les questions spécifiques relatives au contenu en collaboration avec les facilitateurs et les acteurs du domaine. Elles seront communiquées en temps utile avant l’événement. Si vous souhaitez participer à leur élaboration, veuillez nous contacter à l’adresse <info@gentechnik-dialog.ch>.
1. Voyage d'apprentissage (DE & FR)
avec Théo Fischer
La méthode :
Le voyage d’apprentissage est un format expérimental qui permet aux participants d’acquérir de nouvelles perspectives grâce à une expérience directe. Au lieu de discuter des défis, les participants entreprennent ensemble un « voyage » organisé vers des lieux, des initiatives ou des acteurs qui travaillent déjà dans la pratique sur des aspects liés à l’avenir ou à la transformation dans le contexte de la coexistence et des nouvelles techniques génétiques.
L’accent est mis sur « l’apprentissage par l’expérience » : les rencontres, les échanges, la réflexion et le dialogue permettent d’acquérir des connaissances qui peuvent ensuite être transposées dans le contexte propre à chacun.
L’objectif est de mettre les participants en contact avec des exemples inspirants et des environnements inhabituels afin d’élargir leur propre perception, d’identifier des schémas et de poser de nouvelles questions.

Qu’il s’agisse d’écosystèmes naturels ou sociaux, une question est au cœur du travail de Théo Fischer : comment pouvons-nous laisser suffisamment de place à la complexité pour qu’elle puisse déployer toute sa magie ?
Son expérience dans le développement organisationnel, la conception de processus d’exploration, la création de jardins en permaculture, l’apiculture, la régénération de vignobles ainsi que la fermentation et la cueillette de plantes médicinales ont nourri sa conviction que nous devons abandonner le contrôle et les plans rigides pour permettre à une véritable résilience de se développer. Tout ce qu’il faut, c’est suffisamment d’espace pour que cela se produise.
Théo se considère comme l’hôte de ces espaces régénérateurs.

Lena Tünkers conçoit des espaces où l’avenir peut être exploré avec curiosité et audace. Forte d’une formation en innovation commerciale, elle allie futurisme artistique et expérimental, réflexion stratégique et économique et profondeur humaine. En tant que facilitatrice internationale et conservatrice, elle accompagne les processus de transformation et les recherches participatives sur l’avenir dans des organisations qui élargissent les horizons de la pensée et ouvrent de nouvelles voies. Outre son activité indépendante, elle est présidente du Foresight Europe Network et explore l’avenir de l’humanité avec le projet transdisciplinaire Humans of Tomorrow.
2. Penser l'avenir
avec Lena Tünkers
La méthode
À quoi ressemblera la coestence à l’avenir ? Quels scénarios possibles ne voyons-nous pas ? Qu’est-ce qui pourrait être complètement différent de ce que nous pensons aujourd’hui ?
Penser l’avenir ne fournit pas de réponses, mais pose des questions – des questions qui éveillent une curiosité audacieuse pour l’inconnu. Les participants vivent un processus guidé fait de changements de perspective, d’acrobaties intellectuelles et de réflexion commune – un espace pour s’émerveiller, questionner et imaginer.
Déroulement :
- Explorer les images du futur : recueillir les premières idées et attentes concernant les futurs possibles.
- Découvrir les incertitudes critiques : identifier les tendances et les signaux ayant une influence importante mais incertaine.
- Rendre les futurs tangibles : visualiser des scénarios alternatifs pour l’avenir.
La méthode repose sur les principes de la Futures Literacy (cf. UNESCO) et du Speculative Design (cf. Dunne & Raby). Elle utilise l’imagination comme un outil pour ne pas éviter l’incertitude, mais la rendre productive. En imaginant des futurs probables, souhaitables et alternatifs, nous élargissons nos espaces de réflexion et d’action.
Cette approche est particulièrement précieuse dans le domaine du génie génétique, qui se situe à la croisée du progrès scientifique, de la responsabilité éthique et de l’ambivalence sociale. Elle permet de supporter la complexité, d’explorer l’ambiguïté et de concevoir l’avenir comme un terrain de jeu ouvert plutôt que comme une continuation linéaire du présent.
En bref, nous cultivons notre imagination, non pas pour faire des prévisions, mais pour apprendre à imaginer des futurs. Car pour façonner l’avenir, il faut d’abord être capable de l’imaginer.
3. Exploration de modèles 3D
L’exploration de modèles 3D sert à rendre visibles, sous une forme matérielle et sous différents angles, des situations complexes, des défis ou des visions d’avenir. À l’aide de matériaux simples – argile, fil de fer, papier ou objets naturels –, les participants créent des modèles qui représentent leur perception actuelle d’un système.
Au cours du processus, le modèle se transforme : de l’état actuel, en passant par l’abandon des anciennes structures, jusqu’à une forme qui exprime l’avenir émergent (en devenir). Le résultat n’est pas un objet esthétique, mais un « instantané » visible, tangible et donc négociable des mouvements et des tendances du système.
Cette méthode permet d’intégrer les connaissances intuitives, les émotions et les relations systémiques, au-delà des analyses purement cognitives. Elle est issue de la théorie U et a été développée par Otto Scharmer et al. au Presencing Institute (MIT).

Severin est consultant systémique et facilitateur de processus pour une transformation efficace, des ateliers innovants, des processus de co-création et des événements interactifs. Depuis plus de 15 ans, il crée des espaces où les gens se réunissent au-delà des cloisonnements, conçoivent ensemble l’avenir et développent des solutions audacieuses et durables.
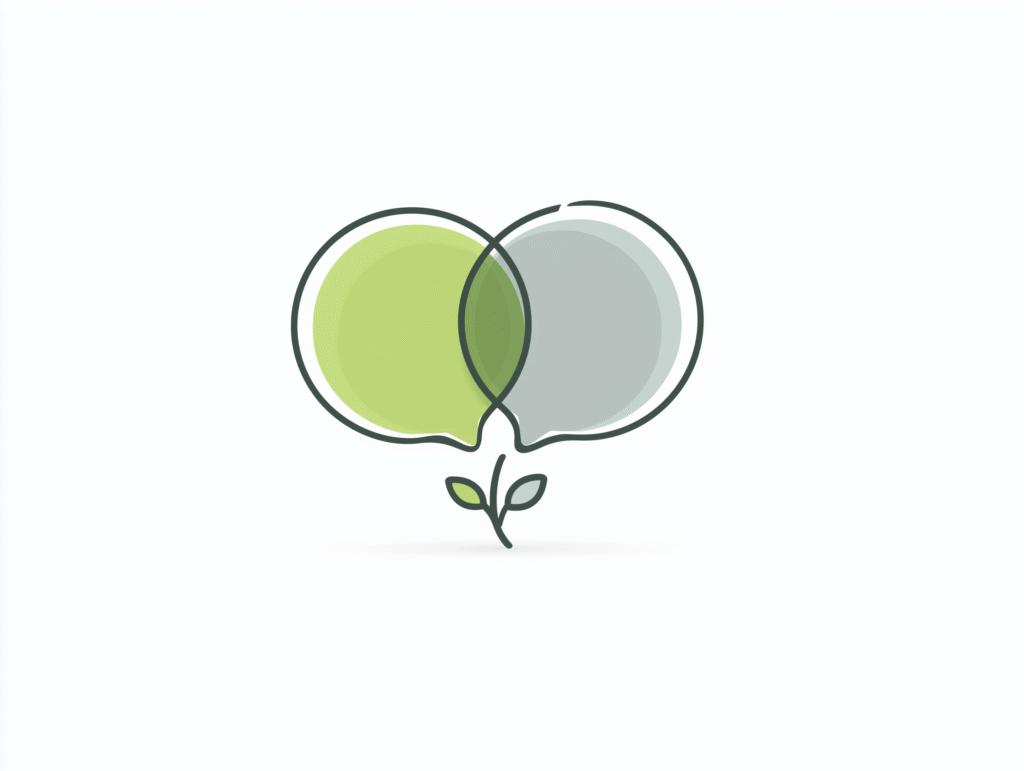
La méthode
Dans le modèle Worldwork du travail sur les processus selon A. Mindell, les conflits ne sont pas seulement traités et résolus sur le plan rationnel et émotionnel, mais également considérés sur la base de l’hypothèse d’un champ intentionnel. Ce travail se concentre sur la construction, la manifestation et l’expérience de l’ensemble du champ de tension.
Lorsque tous les niveaux de l’apparence et de l’expérience sont pris en compte dans le traitement – y compris les expériences difficiles à formuler ou non verbales –, le champ de tension continue à se développer de lui-même et prend une direction qui ouvre de nouvelles perspectives et possibilités d’action.
4. Travail sur les processus
Les questions clés dans le travail sur les processus sont par exemple :
Comment ce champ de tension tente-t-il de se développer ? Dans quelle direction veut-il évoluer ?
Le travail sur les processus est une approche intégrative du monde de l’expérience humaine, tant au niveau individuel qu’au niveau des organisations ou des communautés. L’accent est mis sur les ressources et les possibilités de conception de l’expérience et de l’action humaines. Les aspects suivants sont particulièrement mis en lumière :
- le potentiel des conflits, des erreurs et des perturbations
- les polarités entre intention et auto-organisation dans les processus de transformation et de développement,
- les différentes perceptions du monde en fonction des origines (diversité), les possibilités créatives et intuitives de la perception émotionnelle,
- ainsi que la perception et l’utilisation du pouvoir (power) comme ressource.
5. Lego Serious Play
Lego® Serious Play® (LSP) est une méthode de stratégie et d’animation développée pour aider les équipes et les organisations à répondre ensemble à des questions complexes. Au lieu de discuter de problèmes de manière abstraite, les participants utilisent leurs mains : ils construisent avec des briques Lego des modèles qui rendent visibles leurs pensées, leurs idées et leurs expériences. Il en résulte un processus qui combine de manière unique la réflexion, les sentiments et l’action, et qui fournit ainsi des résultats efficaces et concrets.
Le processus en 4 étapes :
- Questionnement : nous posons une question aux participants en fonction de l’objectif de l’atelier. Cette question est précisément adaptée à l’objectif et vise à inciter les participants à réfléchir à leurs perspectives et à leurs réponses.
- Construction des modèles : au cours de cette phase, les participants utilisent des briques Lego pour construire des modèles individuels qui représentent leurs réponses, leurs réflexions ou leurs perspectives. Comme les participants n’échangent pas entre eux, ils ne s’influencent pas mutuellement, ce qui nous permet d’obtenir des réponses très honnêtes et variées.
- Partage des récits et des contenus : les participants partagent leurs modèles avec le groupe et en expliquent la signification. Cette étape est essentielle pour révéler les points de vue individuels et favoriser une compréhension commune. Les modèles construits facilitent non seulement la communication visuelle, mais aident également à exprimer clairement et de manière compréhensible vos pensées et vos idées.
- Discussion et solutions : au cours de l’échange, les modèles sont mis en relation les uns avec les autres afin d’identifier les liens systémiques et de créer une compréhension plus approfondie de la situation globale. Cette étape sert de base pour identifier des modèles et développer des solutions concrètes. La phase de réflexion permet de relier les perspectives individuelles aux objectifs collectifs et de définir ensemble des options d’action.

Florian Wieser est un entrepreneur pirate.
En tant que tel, il nous invite à plus de non-conformisme et de « well performing », c’est-à-dire à une performance ambitieuse et saine, loin de l’auto-exploitation.
Aujourd’hui, il est mentor pour les cadres, enseignant en intelligence émotionnelle et formateur pour LEGO®️ Serious Play. Grâce à cet outil, il accompagne depuis de nombreuses années des processus de transformation, allant de la culture d’équipe à la clarification de soi en passant par la réorientation stratégique. Pour lui, LEGO Serious Play est une attitude qui consiste à penser avec ses mains, à apprendre ensemble avec son cœur et à créer par conviction.
Il croit en une société créative : un avenir dans lequel les gens ne se contentent pas de fonctionner, mais créent, en connexion avec eux-mêmes, avec le tout et avec une vocation créative claire.
Plus d'informations sur l'approche systémique
Le matin, plusieurs formats de dialogue systémique se déroulent en parallèle, allant du travail créatif en groupe à des méthodes systémiques expérientielles. L’objectif est de rendre visibles et tangibles de nombreuses perspectives différentes afin de pouvoir les mettre en relation de manière plus nuancée et plus efficace par la suite. L’après-midi, nous rassemblerons les expériences et les connaissances acquises lors de discussions communes : nous rechercherons des liens, poserons des questions ouvertes, apprendrons les uns des autres – et peut-être que les premières idées ou impulsions pour les prochaines étapes au-delà de l’événement se manifesteront déjà.
L’espace de dialogue ainsi créé doit contribuer à développer une compréhension plus profonde les uns des autres et à instaurer la confiance, même au-delà des différentes positions et convictions. Ensemble, nous réfléchissons à la manière dont nous pouvons participer à la construction de notre avenir dans la diversité. Nous favorisons ainsi le terreau nécessaire à de futures coopérations et impulsions politiques qui s’orientent vers les besoins et les perspectives réels, même au-delà de nos propres horizons
Cet événement dialogue se veut un espace d’apprentissage social dédié à l’étude de la coexistence avec les nouvelles techniques génétiques dans l’agriculture suisse. Cette question touche à la fois les dimensions scientifiques, politiques, éthiques, écologiques, historiques, juridiques, agronomiques et émotionnelles. Elle constitue donc un exemple typique de ce qu’on appelle un « wicked challenge » (Rittel & Webber, 1973) : un défi complexe, ambigu et dynamique pour lequel il n’existe pas de solution claire, mais seulement des processus de négociation communs.
Au lieu de réduire la complexité par des stratégies autoritaires ou compétitives, par exemple, nous souhaitons la rendre consciemment tangible et négociable dans ce cadre collaboratif. L’approche méthodologique combine donc différents volets de la pratique de recherche systémique et participative qui visent à permettre l’apprentissage collectif, la diversité des perspectives et les processus de connaissance émergents. Les formats simultanés proposés le matin (Learning Journey, modélisation 3D, conception spéculative, théâtre social, Worldwork, Lego® Serious Play®) permettent une approche multiperspectiviste et multimodale des mêmes questions. Cette simultanéité permet une confrontation polyphonique, vivante et dynamique avec la situation actuelle.
Au cœur de cette approche se trouve la prise de conscience que les questions complexes ne peuvent être traitées de manière isolée, par exemple uniquement sous l’angle technique, juridique ou éthique. Les défis sociaux tels que les nouvelles technologies génétiques, le climat, l’alimentation ou la santé sont des systèmes vivants et interdépendants dans lesquels les causes, les relations, les effets et les significations (modèles mentaux) sont liés entre eux de manière interdépendante (cf. notamment Bateson 1972, Luhman 1984 et Meadows, 2008).
Un changement efficace dans des systèmes de ce type ne passe pas par des solutions isolées, mais par un travail sur les relations, les schémas et les modèles mentaux – les structures profondes d’un système, car chaque intervention génère également de nouvelles rétroactions. Le concept de « warm data » (2018) de Nora Bateson élargit et soutient cette vision : la connaissance ne naît pas uniquement dans des ensembles de données ou des faits, mais dans les relations entre les personnes, les contextes et les significations. Toute connaissance, aussi « objective » soit-elle, s’inscrit dans une multitude de contextes socioculturels, écologiques et institutionnels concrets – dans des réseaux de relations où les individus, avec leurs réalités de vie, leurs expériences, leurs besoins et leurs visions du monde spécifiques, interagissent en permanence avec les systèmes politiques, économiques et écologiques.
Le succès de cet événement dialogue ne se définit donc pas par une éventuelle clarification ou harmonisation des positions et des opinions, mais par l’approfondissement de la perception mutuelle. Le succès se manifeste lorsque nous pouvons entrer en relation avec « l’autre », lorsque de nouveaux liens significatifs se créent, lorsque des perspectives jusqu’alors distinctes se rejoignent et évoluent ensemble, et lorsque nous pouvons intégrer ces informations/perspectives dans notre contexte individuel.
Le concept de « grande co-création », inventé par Jascha Rohr (2021), décrit la capacité des sociétés à développer ensemble de nouvelles formes d’organisation, de pensée, de sentiment et d’action. En ce sens, la co-création décrit une pratique culturelle qui va au-delà de la participation classique : l’événement de dialogue est considéré comme un champ d’exploration commun et un espace de résonance sociale dans lequel les visions d’avenir, les tensions et les possibilités peuvent s’exprimer. Les gens se réunissent non seulement pour concevoir des solutions, mais surtout pour élargir leur perception et leur compréhension dans une sphère d’apprentissage collective.
Le concept de co-création est étroitement lié à l’idée des plateformes multipartites (MSP), telle qu’elle est décrite dans le guide MSP de Brouwer et al. (2016). Ce guide souligne que des solutions durables ne peuvent voir le jour que lorsque les connaissances issues de différents systèmes – scientifiques, locaux, émotionnels, institutionnels – se rencontrent dans un espace d’apprentissage commun.
La co-création élargit la notion de savoir transdisciplinaire, comme dans les processus multipartites (cf. Brouwer et al 2016) à l’apprentissage et à la découverte transcontextuels, en tissant non seulement des liens entre les disciplines (scientifiques), mais aussi entre différents contextes d’expérience, de pratique, de signification et de vie, afin de susciter une compréhension commune et de nouvelles actions collectives.
Arturo Escobar (2018) élargit cette perspective dans Designs for the Pluriverse : la co-création est ici un acte de conception ontologique – la création consciente de mondes dans lesquels de nombreuses réalités (« plurivers ») peuvent coexister. Au lieu de viser une vision universelle de l’avenir, il s’agit de créer des espaces dans lesquels différentes cosmologies, formes de connaissance et modes de vie dialoguent dans le respect.
Ainsi comprise, la manifestation-dialogue devient un laboratoire de réflexion commune qui cultive non pas le consensus, mais la coexistence et la création commune de sens – en s’inspirant des approches décoloniales et relationnelles-écologiques du design et du changement systémique.
La théorie U défend notamment la position suivante : si nous voulons agir de manière durable, il est important que cela résulte d’une réflexion en résonance avec les processus émergents et non de schémas de pensée qui reposent sur des hypothèses qui ne sont plus (ou ne seront plus) valables sous leur forme actuelle. Pour y parvenir, il est proposé de faire une pause consciente entre la perception et l’action, au cours de laquelle le ralentissement, la résonance et l’observation attentive permettent de voir ce qui est en train de se former.
Scharmer décrit ce processus comme un mouvement le long du « U » : du « téléchargement » de schémas bien rodés à la pause et à l’ouverture, jusqu’à l’émergence de nouvelles possibilités. Entre la perception et l’action, une zone de présence se crée – un espace conscient de non-savoir dans lequel l’intuition, l’empathie et le sentiment collectif peuvent se déployer.
Au centre se trouve le passage d’un « savoir sur » à un « être avec » – une attitude cognitive qui ne considère pas la connaissance comme un objet distant, mais comme le résultat d’une relation et d’une attention incarnée. En ce sens, la théorie U est liée à l’épistémologie systémique de Gregory Bateson et à la pensée relationnelle-systémique de Nora Bateson (Warm Data, 2018).
Ce « presencing » – un mot-valise formé à partir de « presence » et « sensing » – désigne le moment où les personnes et les systèmes entrent en contact avec l’avenir qui veut se déployer à travers eux. La transformation ne se fait pas par la seule force de la volonté, mais par la capacité d’écouter – non seulement les uns les autres, mais aussi ce qui se passe « entre » nous.
Le processus U devient ainsi lui-même un espace d’expérience sociale, un réceptacle dans lequel s’exercent la pleine conscience collective, le ralentissement et la résonance. Dans le langage de la théorie U, cet espace est rendu possible par trois ouvertures :
l’esprit ouvert (open mind) – la volonté de remettre en question ses propres certitudes,
le cœur ouvert (open heart) – la capacité à se laisser toucher par les autres,
et la volonté ouverte (open will) – l’abandon des anciennes intentions afin de faire place au changement et à la nouveauté.
De l’expérience individuelle à la création collective
La théorie U considère les systèmes sociaux comme des organismes en apprentissage. Faire une pause dans le « U » n’est pas un retrait, mais une perception collective profonde d’où naît l’intelligence créatrice – une capacité qui va au-delà de la planification rationnelle et permet d’appréhender l’avenir comme un processus relationnel.
La théorie U s’inscrit ainsi dans la continuité directe de la co-création (Rohr 2021), de l’apprentissage transcontextuel (Bateson 2018) et des Designs for the Pluriverse (Escobar 2018) : ces trois approches traitent de la création à partir de la relation et du dialogue.
Dans l’ensemble, nous considérons cette journée comme un laboratoire pour les processus d’apprentissage social. L’événement est un espace d’expérience ouvert dans lequel les acteurs issus des milieux scientifiques, politiques, pratiques et de la société civile peuvent tester de nouvelles formes de compréhension.
L’interaction entre les méthodes, la physicalité, le discours et la réflexion permet un apprentissage ancré sur les plans cognitif, émotionnel et relationnel. L’espace de dialogue ainsi créé doit servir de terreau fertile pour de futures coopérations, des impulsions politiques et une responsabilité commune approfondie pour ce qui se développe.
LIVRES
Bateson, Nora (2023). Combining. Triarchy Press.
Brouwer et al. (2019). The MSP Guide. <https://mspguide.org>.
Escobar, Arturo (2018). Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy and the Making of Worlds. Duke University Press.
Isaacs, Williams (1999). Dialogue: The Art of Thinking Together. Penguin Random House
Luhman, Niklas (1984). Soziale Systeme. Suhrkamp
Meadows, Donella H. (2008). Thinking in Systems. Chelsea Green.
Meadows, Donella H. Leverage Points. <https://donellameadows.org/archives/leverage-points-places-to-intervene-in-a-system>
Rohr, Jascha (2021). Die grosse Kokreation. Eine Werkstatt für alle, die nicht untergehen wollen. Murmann.
Scharmer, C. Otto (2016). Theory U: Leading from the Future as it Emerges (2nd. Edition)
VIDÉOS
Isaacs, William. Conversations that Change the World. MIT Sloan School of Management. Youtube
